hatti [ha-at-ti]
association des amis de la civilisation hittite

Menu:
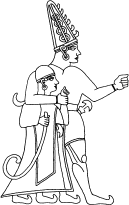
L'ANATOLIE AVANT LES HITTITES
Le paléolithique et le mésolithique
par Alain Gaulon, Paris.
Nos connaissances sur le peuplement de l’Anatolie depuis le Paléolithique
sont lacunaires. En effet, si cette région à été habitée de façon
plus ou moins dense pendant tout le Paléolithique, elle présente une
absence de données pour la période suivante. Cette absence a longtemps
été interprétée comme le résultat d’une insuffisance des
recherches. Aujourd’hui, la préhistoire de l’Anatolie peut être
complétée grâce aux nouvelles données que sont les travaux sur
l’environnement et les récentes prospections.
Les sources
Nos informations proviennent de trois types de source: l’environnement, les prospections et les fouilles. Les travaux des géologues et des palynologues nous ont apporté des informations précieuses sur cette époque. En effet, le climat était froid et sec, les limites des neiges étaient plus basses qu’à présent et l’étendue des lacs à la fin du pléistocène offrait un paysage peu favorable à l’homme, surtout pour les habitats en plein air. Des fouilleurs ont effectué plusieurs prospections dans les années 1940-1960. Les résultats de toutes ces prospections sont publiés sous forme de notes. Malheureusement, celles-ci sont très souvent lacunaires et il est difficile d’en tirer les informations utiles. Parmi les travaux plus récents, une prospection en Anatolie centrale n’a rien donné d’antérieur au Néolithique précéramique et une prospection dans le sud-est de l’Anatolie par Benedict n’a rapporté que quelques éléments nouveaux à propos de deux sites, Biris et Sögüt Tarlası. Il semblerait que ces deux sites soient finalement plus récents que ne le pense le fouilleur. Enfin, depuis le lancement d’un programme de grands barrages dans l’est de l’Anatolie, les régions vouées à l’inondation ont fait l’objet de prospections systématiques comme la région du Keban par Kökten en 1971-76 et Whallon en 1979: les résultats indiquent un vide entre le Paléolithique supérieur et le Néolithique. Finalement, seuls deux sites en abri sous roche, Belbaşı et Beldibi ont été vraiment fouillés (figure 1).Les premières traces humaines en Anatolie
Si on trouve des traces de l’occupation humaine en Anatolie aux environs de 700 000 avant J-C., c’est seulement vers 70 000 av J-C. qu’on peut réellement observer les premiers établissement humains. Dans la région d’Antalya, au sud du plateau anatolien, se trouve la grotte de Kara’in fouillée à partir de 1946, puis à nouveau en 1974 par K. Kökten. Huit niveaux appartenant aux trois grandes périodes du Paléolithique y ont été reconnus et, selon le fouilleur, l’occupation s’étendrait jusqu’au Néolithique. Si l’on trouve des bifaces acheuléens du Paléolithique Inférieur, outils qui sont parmi les plus anciens outils connus en Anatolie, on peut mentionner, pour la phase suivante, la présence de pointes triangulaires et de grattoirs. Au Paléolithique Supérieur, l’outillage se diversifie et les lames prennent une plus grande importance. Toutefois, les conclusions avancées ont été remises en cause et des fouilles ont repris récemment. Les microlithes posséderaient des influences techniques du Levant (Hours, Aurenche, Cauvin, Cauvin., Copeland., Sanllaville 1994: 197). La présence de Paléolithique Moyen et de Paléolithique Supérieur récent semble établie. En outre, il existe du matériel néolithique consistant en tessons noirs lustrés et d’autres peints en rouge ou crème. Des recherches entreprises depuis 1990 ont permis l’étude de la côte méditerranéenne de Turquie, qui demeure fort mal connue. Lors de prospections menées entre le Mont Amanus et le Mont Cassius, deux grottes (Üçagizli I et II) assez proches du niveau actuel de la mer ont été redécouvertes. Dans la première grotte, des niveaux datés des environs de 30 000 av J-C., avaient déjà été fouillés par Kökten en 1946. Ces niveaux sont apparus dès la surface et contenaient des vestiges de faune. L’industrie est caractérisée par un débitage où prédominent les éclats et les lames. Les niveaux sous-jacents peuvent être attribués au Paléolithique Moyen.Le Mésolithique
Le Mésolithique est une phase décisive de la préhistoire car elle voit la sédentarisation d’une partie au moins de la population qui se met alors à pratiquer un début, rudimentaire encore, d’agriculture. Les populations paléolithiques occupaient principalement des grottes ou abris sous roches, même si elles devaient se déplacer parfois pour suivre le gibier. Belba şıest un abri sous roche, sur la côte méditerranéenne, dans la baie d’Antalya. Les fouilles ont été effectuées par Bostancı, dont nous avons deux rapports préliminaires. Il a distingué trois niveaux. L’information repose surtout sur l’industrie lithique en silex qui est lamellaire et caractérisé par des lamelles fines. L’outillage est composé essentiellement de microlithes mais aussi de grands outils caractéristiques du Paléolithique (Balkan-Atlı 1994: 51). Bostancı et Balkan-Atlı pensent que cet outillage se rapproche de celui de Kebara C en Palestine (ce serait donc du Kébarien). Toutefois, les données sont trop approximatives pour pouvoir trancher dans cette hypothèse. L’abri sous roche de Beldibi se trouve à 5 Km au nord-est de Belbaşı. Les fouilles furent menées entre 1959 et 1968 par Bostancı. Les quatre niveaux mésolithiques ont livré des microlithes rappelant ceux du Natoufien (période Mésolithique) de Palestine et des faucilles sans doute utilisées pour recueillir les céréales sauvages. Ces niveaux reposaient sur une couche stérile qui est, elle-même, sur une couche du Paléolithique Supérieur. Les couches supérieures fournissaient aussi de la céramique grossière couverte d’une patine rouge. Bostancı attribuait cet ensemble au Mésolithique mais il est probable, comme le pensent Mellaart et Balkan-Atlı, que la céramique est postérieure (Mellaart 1965: 78; Balkan-Atlı 1994: 53). Beldibi présente également un art artistique qui n’existe pas sur d’autres sites. Cet art se présente sous deux formes: des galets peints à l’ocre représentant des figures schématiques d’une part, et des représentations pariétales également en ocre et représentant des figures schématiques d’autre part. Toutefois, les données du fouilleur sont douteuses et il est impossible d’attribuer raisonnablement ces représentations au Mésolithique (figure 2). D’autres sites, connus par des prospections, sont souvent attribués au Mésolithique: Dervişhanı (Cohen en 1970), Macunçay (Kansu en 1952), Baradız (Kansu en 1945)... mais leur attribution à une période précise est fort douteuse. Ainsi, les dernières recherches ne permettent pas d’appréhender l’occupation humaine durant le Paléolithique et le Mésolithique. Les fouilles et les prospections sont insuffisantes pour comprendre la densité et l’évolution des groupes humains en Anatolie. Pourtant, dans le Levant, à la fin du Mésolithique, différentes entités commencent à se sédentariser et à pratiquer d’autres moyens de subsistance que la chasse ou la cueillette. Si les deux principaux sites, Beldibi et Belbaşı, entrent dans la chronologie du Paléolithique du Levant comme le montrent les affinités du point de vue technologique et typologique avec le Kébarien et le Natoufien (deux périodes culturelles du Levant), il semble que certaines techniques de taille et surtout les représentations dans l’art soient inconnues du Levant. Il est probable que des contacts existent entre les deux régions mais nous manquons encore de données pour ces périodes anciennes. Il en est autrement pour l’émergence du Néolithique en Anatolie.BIBLIOGRAPHIE
- ALKIM U.H. (1968), Anatolie I: des origines à la fin du IIème millénaire av J.-C., Genève.
- ANATI E. (1968), «Anatolia’s Earliest Art», Archeology 21/1, p. 22-35.
- BALKAN-ATLI N. (1994), La Néolithisation de l’Anatolie, Paris.
- BOSTANCI E.Y. (1966), «The Mesolithic of Beldibi and Belbasi and the Relation with the Others Findings in Anatolia», Antropoloji 3, p. 91-142.
- DESTI M. (1998), Les Civilisations anatoliennes, Paris.
- HOURS F., AURENCHE O., CAUVIN J., CAUVIN M.C., COPELAND L., SANLAVILLE P. (1994), Atlas des sites du Proche-Orient (14000-5700 B.P.), 2 volumes, Paris.
- JOUKOWSKI M.S. (1996), Early Turkey, Dubuque.
- MELLAART J. (1965), Earliest Civilization of the Near East, London.
- MELLAART J. (1975), The Neolithic of the Near East, London.