hatti [ha-at-ti]
association des amis de la civilisation hittite

Menu:
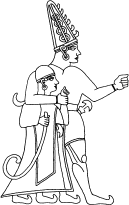
REMARQUES A PROPOS DES ENFERS DANS LE MONDE HITTITE ET LE MONDE GREC
par Catherine Saint-Pierre et Cécile Colonna, Paris.
Chaque civilisation a proposé sa propre vision de l’au-delà. Mais les mythologies se sont souvent enrichies par des contacts avec les civilisations mitoyennes et certaines conceptions ont pu se transmettre. Cependant, lorsque les éléments sont analogues dans plusieurs civilisations séparées dans l’espace et dans le temps, il est parfois possible d’envisager une origine commune. Dans le cas de la conception hittite et grecque des Enfers, il semble que certains éléments aient été empruntés par la civilisation grecque aux civilisations anatoliennes, sans qu’on puisse reconstituer les conditions de cet emprunt, et que d’autres éléments communs s’expliquent par une même origine indo-européenne.
La cosmogonie hittite est très mal connue. Les textes et sources concernant notamment les Enfers font souvent défaut aux chercheurs et les placent dans une ignorance relative des conceptions hittites sur l’autre monde. Parmi les milliers de tablettes trouvées à Bogazkoy, aucune ne renferme une cosmogonie hittite proprement dite. La documentation à notre disposition est très parcellaire et se trouve au hasard des textes, souvent dans des formules figées.
Notre plus ancienne source grecque est Homère, poète épique à qui on attribue l’Iliade et l’Odyssée. Sa vie était inconnue des Grecs eux-mêmes, et sa figure demeure énigmatique: des débats opposent les chercheurs sur son existence même. Toujours est-il que les deux poèmes ont été rédigés sans doute à la fin du VIIIème siècle. Ils sont le résultat d’une tradition ionienne de poésie orale vieille de plusieurs siècles. Certains éléments peuvent remonter à la période mycénienne (environ 1400-1200 avant notre ère), mais ils sont peu nombreux. L’élaboration des poèmes eut lieu durant les siècles obscurs à partir d’environ 1000 avant notre ère: des caractères évidents de la société de l’époque ont été incorporés. La réalité décrite est donc une construction artificielle d’éléments de sociétés qui s’étalent dans le temps, mais dans une large mesure, Homère présente un portrait de la société grecque de la fin des siècles obscurs (IXème et VIIIème siècles) Ces deux poèmes évoquent la guerre de Troie, qui pourrait avoir eut lieu vers 1250-1200 avant notre ère: L’Iliade narre un épisode de la guerre, "la colère d’Achille", et l’Odyssée raconte le long retour tumultueux d’Ulysse dans sa patrie Ithaque après le conflit. Homère ne décrit donc pas exactement les Enfers (l’Hadès, l’Erèbe), mais il y fait allusion à de nombreuses occasions, lors de discours des personnages, de leur mort, ou du périple d’Ulysse parti interroger le devin Tirésias dans le domaine des morts. Ces divers éléments nous permettent donc d’avoir une idée de la civilisation grecque de cette époque.
Dans le monde grec, les textes donnent une description quelque peu contradictoire des Enfers. Nous retrouvons pourtant certaines constantes, comme celle selon laquelle de l’eau sépare le monde des vivants du monde des morts. Mais la géographie infernale est souvent confuse. On ne sait pas si le Tartare et les Champs Elysées font partie du royaume d’Hadès ou s’ils en sont distincts.
La conception que les Hittites et les Grecs se font de l’univers est analogue. Selon les Hittites, l’univers est constitué de trois parties: le Ciel, la Terre et le Monde Souterrain (les Enfers). Cette division tripartite de l’univers se retrouve dans la mythologie grecque (voir schéma 1) : selon Homère et Hésiode le monde a été partagé entre les trois fils de Cronos, Zeus qui règne sur le ciel, Poséidon qui règne sur les mers et Hadès le maître des Enfers (Iliade XV, V. 184-195; Théogonie, V. 455-458). Les niveaux supérieurs et inférieurs sont représentés dans les deux civilisations par le Ciel et les Enfers, mais le niveau intermédiaire est représenté chez les Hittites par la terre, chez les Grecs par la mer. D’autres conceptions de l’univers sont suggérées chez Homère: selon un autre passage de l’Iliade (VIII, 13-18), le monde est composé de quatre éléments selon un axe vertical: le ciel, la terre où vivent les hommes, les Enfers, et le Tartare, prison des Titans vaincus par les dieux Olympiens, "aussi loin de l’Hadès que le ciel est au-dessus de la Terre". Par contre, dans l’Odyssée, ils sont situés au-delà du fleuve Océan qui coule autour d’une terre imaginée comme un disque plat, mais restent souterrains (voir schéma 2). L’Hadès est donc situé soit dans un au-delà souterrain, comme dans la conception hittite, soit à l’extrême limite du monde habité.
Dans les deux conceptions hittite et grecque, le soleil, quand il se couche, continue sa course nocturne sous terre dans les Enfers, pour réapparaître à l’aube. Dans l’Odyssée, le lieu où le soleil s’enfonce dans la nuit est marqué, à côté de l’entrée de l’Hadès, par une Roche Blanche.
La principale divinité infernale du panthéon hittite est une divinité d’origine hatti (Lelwani). Elle a été assimilée à une divinité solaire sumérienne (Ereškigal), elle-même très anciennement assimilée en Asie Mineure à la déesse solaire de la Terre, changeant du même coup de sexe (divinité masculine chez les Hattis, féminine chez les Hittites). L’assimilation de Lelwani et d’Ereškigal a dû se faire à une date très ancienne. Elle est aussi l’équivalent de la déesse hourrite Allani. Enfin dans la tradition de l’ancien Empire hittite, la déesse du Soleil du pays Hatti, la parèdre du dieu de l’Orage, maître du Ciel, est en même temps la déesse de la Terre et des Enfers. Cette analogie se retrouve dans la tradition sumérienne où Ereškigal, l’épouse du "maître de la Terre" Ninazu règne sur les Enfers. Ereškigal correspond à la déesse babylonienne Allatum dont le nom se retrouve chez la maîtresse des Enfers hourrite Allani "la maîtresse". Dans la cosmogonie grecque, comme nous l’avons signalé, au terme du partage du monde c’est à Hadès qu’est échu le royaume des Enfers. Pourtant, comme chez les Hittites, c’est une divinité féminine qui prédomine dans l’Odyssée: il s’agit de Perséphone, fille de Déméter et Zeus, épouse d’Hadès. C’est elle qu’Ulysse voit régner aux Enfers et commander aux morts. C’est "la souveraine silencieuse des morts", "la Noble", "la Terrible", "la Pure".
Le cercle de Lelwani et celui d’Ereškigal sont totalement distincts. Le premier cercle près d’Isdustaya et de Papaya, est constitué de divinités d’origine hattie. Le second, est formé des Anunnaki, dieux étrangers d’origine hourrite et mésopotamienne, considérés jadis comme les "Seigneurs de la Terre" qui furent chassés et confinés dans les Enfers par le dieu de l’Orage. divinité principale du panthéon hittite. De la même façon, les Titans, fils d’Ouranos (le Ciel) et de Gaia (la Terre), après un combat violent contre les dieux olympiens, ont été refoulés par Zeus dans le Tartare.
La souveraine des Enfers hittites et hourrites est entourée de serviteurs divins. Une prière de l’Ancien Empire dédiée à la déesse du Soleil de la Terre donne leurs noms ou épithètes: "divinité LAMNA de la déesse du Soleil de la Terre", "serviteur de la déesse du Soleil de la Terre", Darawa, Parâya, Hilašši, "le génie de la cour de la porte" (des Enfers). Les poèmes homériques ne mentionnent pas de tels serviteurs.
Les Enfers tant hittites que grecs sont avant tout un lieu de mort mais les divinités infernales sont liées à l’agriculture et donc sources de vie. Les divinités des Enfers garantissent l’agriculture et la prospérité des produits des champs. Cette ambivalence est visible aussi bien dans le mythe hittite appelé le Mythe de Télipinu que dans le mythe de Perséphone rapporté par Hésiode dans la Théogonie et par l’Hymne homérique à Déméter. Dans le Mythe de Télipinu, ce sont les divinités infernales auxquelles se sont joints Télipinu et des divinités agraires, qui procèdent au rétablissement du processus de reproduction interrompu par le départ de Télipinu (KUB XVII 10, III 28-34). Dans le mythe grec, la fille de Déméter, déesse du Blé et de la Fertilité, la patronne de l’agriculture en général, fut enlevée par Hadès, ce qui provoqua le désespoir de sa mère, et entraîna la stérilité des terres cultivées. Zeus voyant l’équilibre du monde menacé, décida que Perséphone passerait une partie de l’année auprès de son époux aux Enfers: c’est l’hiver, saison où la terre ne produit rien, et l’autre partie avec sa mère, sur terre, permettant ainsi les récoltes (voir fig. 1).
Une autre fonction des divinités infernales hittites est leur présence dans les serments officiels. Les dieux grecs quant-à eux prêtent serment dans les poèmes homériques sur le Styx, fleuve infernal. C’est la même relation entre l’eau et le monde souterrain qui procure les bases des rituels concernant les serments en rapport avec l’eau dans les traditions hittites, grecques et sanskrites.
L’entrée des Enfers est localisée par les Hittites et les Grecs à l’ouest, là où le soleil se couche, dans une région de steppes. Un mythe mésopotamien raconte que Dumuzi, le dieu de l’agriculture et de la végétation mourante et renaissante, atteint les Enfers par les steppes occidentales. Pour Homère, c’est aux confins du monde, chez les Cimmériens, pays plongé dans une ombre brumeuse qui masque le passage vers l’Erèbe. L’entrée est liée au côté du couchant, des ténèbres.
Comme nous l’avons mentionné, la limite entre le monde des humains et l’au-delà est formé par de l’eau, qui doit être traversée pour atteindre les Enfers. L’épopée de Gilgameš mentionne une auberge se trouvant sur le chemin vers l’au-delà. Elle est tenue par une marchande de vin au nom Hourrite Zidur/ šiduri "la jeune fille". Cette dernière renseigne le héros sur le moyen d’accéder aux Enfers grâce au nocher du fleuve des Enfers Hudur. Dans le rituel de Pabilili (KUB 39.71 36 Ro 8), une petite embarcation est mentionnée suivant le modèle babylonien. Différents fleuves séparent pour les Grecs les Enfers du monde des humains. Tout d’abord le fleuve Océan, à la fois un fleuve périphérique dont les neuf anneaux entourent le monde et un fleuve souterrain, le premier des grands cours d’eau qui séparent les vivants et les morts. Styx, la fille d’Océan, est en fait le dixième anneau qui est l’enceinte de l’univers: en même temps limite cosmique et infernale. Enfin, Cocyte, un bras du Styx, se joint à Pyriphlégéton, un fleuve de feu, pour former l’Achéron, que les âmes doivent traverser sur la barque du nocher Charon. C’est un mélange chaotique de feu et d’eau stygienne, glaciale comme les Enfers eux-mêmes.
Une fois le fleuve des Enfers franchi, le défunt hittite se retrouve devant des murailles munies de sept portes et de sept verrous. D’ailleurs, portes et verrous marquent la région limitrophe entre ce monde-ci et l’au-delà. Pour l’accès aux Enfers, les textes mentionnent constamment la ou les portes des Enfers, c’est à dire du palais des Enfers où règne la déesse du Soleil de la Terre. Le motif des sept murailles ou portes verrouillées remonte aux Sumériens pour lesquels chaque porte est gardée par un portier, en général un dieu ancien. Le plus important est le portier Neti (en sumérien,) ou Nedu (en akkadien). La représentation des Enfers dans le mythe de Telipinu, dieu agraire et fondateur, reprend l’image des sept portes verrouillées (KUB XVII 10, IV 14) . Dans un rituel du Moyen Empire, la déesse du Soleil de la Terre "doit ouvrir" "la porte de la Terre". Homère parle "du palais d’Hadès aux larges portes" et cite constamment les portes menant aux Enfers. On y accède par le bosquet de Perséphone, une avenue de hauts peupliers et de saules stériles, à l’extérieur de laquelle veille un monstre. Par ailleurs, les textes hittites de purification, mentionnent l’existence, dans la "Terre Noire" des Enfers, d’un chaudron pourvu d’un couvercle de plomb, qui retient les impuretés (KUB XVII 10, IV 15-19).
Le paysage hittite des Enfers ressemble tout à fait à celui connu par les traditions mésopotamiennes. Le pays "d’en bas" est une sorte d’image inversée, de reflet de la terre habitée. Dans la cosmogonie hittite, tous les fleuves et rivières ont deux cours: un courant aérien et un courant souterrain. Il est donc possible pour les dieux de passer du monde habité aux Enfers et vice-versa par les mers, les lacs et les fleuves, comme le montre un rituel du dieu du temps de Nérik, ou encore par des grottes et cavités naturelles ou artificielles.
Les Enfers portent le nom de "Terre Noire" ou "Terre Obscure". Dans l’imaginaire hittite, ils sont un lieu de désolation, tout comme les Enfers assyro-babyloniens où ils sont appelés "la maison des ténèbres" ou "le fourré du tourment et de la peine". Dans l’imaginaire grec c’est le domaine de l’humide et du moisi, de la pure ténèbre, de l’Erèbe: un endroit effroyable qui doit rester clos aussi bien aux morts qu’aux immortels. On y rencontre des bois funestes, des fleuves dans un paysage rocheux et escarpé qui apparaît essentiellement chaotique et stérile.
C’est donc un paysage de désolation qui semble être le lieu de résidence des morts ordinaires. Là, "ils ne sont plus que poussières", comme le dépeint le chant d’Ullikummi, un mythe hourrite. Pour le commun des mortels, "la vie est liée à la mort, la mort à la vie", "les jours de l’homme sont comptés". Déjà, aux Enfers mésopotamiens, la vie y est précaire et supportable seulement si la descendance des défunts prend soin d’eux par des sacrifices réguliers. Dans la conception homérique, c’est sous la forme d’une ombre fantomatique que les morts errent dans l’Hadès: ils ont gardé leur apparence corporelle mais ont perdu leur force physique, leurs souvenirs et leurs sentiments. Ainsi Achille affirme: "Ah! un je ne sais quoi, sans doute, continue à vivre chez Hadès: une âme ou bien une ombre où la force n’est plus". Tous les morts cependant ne connaissent pas le même sort. Si la majorité des défunts rejoint les Enfers, il existe dans les deux conceptions hittite et grecque, une catégorie à part. Pour les Hittites, il s’agit du roi qui est divinisé à sa mort et de sa famille. Après certains rites de passages, le roi est accompagné par la "mère", sorte de divinité psychopompe, qui pourrait être une figure de la déesse du Soleil de la Terre, vers un monde supraterrestre. Ce monde se trouverait aux cieux et serait pourvu de pâturages divins où le roi , résidant parmi les dieux, emmènerait paître son troupeau. Pour les Grecs seuls quelques rares héros obtiennent un sort meilleur. Ainsi Protée prophétise que Ménélas ira "aux Champs Elysées, tout au bout de la terre, chez le blond Rhadamanthe, où la plus douce vie est offerte aux humains, où sans neige, sans grand hivers, toujours sans pluie, on ne sent que zéphyrs, dont les risées sifflantes montent de l’Océan pour rafraîchir les hommes", car c’est l’époux d’Hélène et donc le gendre de Zeus. Cette conception de prairie de l’au-delà commune aux deux peuples est une survivance d’un fond indo-européen commun. On peut rapprocher le grec Elusios leimon, Homère Elusion pedion "champs élysées" et le hittite wellu-, d’une forme commune indo-européenne *wel- "pâturage; demeure de la mort", cf. par exemple louvite u(wa)lant- "mort"; tocharien A walu "mort", lithuanien Veliuona "dieu de la mort". Ce n’est qu’à l’époque classique (Vème-VIème siècles) que la conception grecque va évoluer, opposant les bienheureux qui iront aux Champs Elysées et les damnés qui iront au Tartare. Les entrées donnant sur les Enfers sont donc visibles et accessibles à tous. Ce sont bien souvent des cavités naturelles et des fosses artificielles, mais également les lits des rivières et des fleuves. C’est de ces lieux que sont invoquées les divinités infernales hittites. Le prêtre laissait également dans chaque tombe de terre un accès direct aux Enfers. Des liens existent entre la terre et l’Hadès. A la surface de la terre s’ouvrent de nombreux chemins qui peuvent conduire directement chez les morts: les cavernes, les gouffres, les lacs.
Le lien principal entre les vivants et les morts, terre habitée et Enfers se fait par le culte des ancêtres. Il existait cependant des cultes et sacrifices rendus aux divinités infernales. Le prêtre entrait en contact avec les pouvoirs des Enfers par un moyen artificiel, en creusant des fosses. Le prêtre y plaçait une échelle en bronze pour que les dieux puissent prendre part aux rituels et un pavillon d’oreille en bronze pour qu’ils puissent entendre les prières (Haas, 1994 : 128 et n. 109). Des animaux étaient sacrifiés pour ces divinités. Le sang restait alors dans les cavités où ils étaient accomplis. Les rites effectués sur les tombes grecques supposent également une communication avec le mort qui boit le sang de l’animal qui a coulé dans la terre. Dans l’Odyssée, les âmes des morts viennent s’abreuver du sang des victimes qu’Ulysse a égorgé au dessus d’une fosse qu’il a lui-même creusé.
BIBLIOGRAPHIE
- BONNEFOY Y.(dir.) (1981), Dictionnaire des mythologies, Paris.
- HAAS V. (1994), Geschichte die Hethitischen Religion, Leiden-New York-Köln.
- LAVEDON P. (1931), Dictionnaire illustré de la mythologie et des antiquités grecques et romaines, Paris.
- PUHVEL J. (1969), "Meadow of the Otherworld in indo-european tradition", KZ 83, pp. 63-69.
- ROSCHER W. H. (1886-1890), Lexikon der Griechischen und Römischen Mythologie, Leipzig.>
- VIEYRA M. (1965), "Ciel et Enfers hittites", RA 59, pp. 127-130.