hatti [ha-at-ti]
association des amis de la civilisation hittite

Menu:
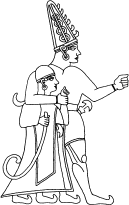
LES PRATIQUES FUNERAIRES EN ANATOLIE
durant la 1ere moitié du IIe millénaire avant notre ère
par Yannis Deliyannis, Paris.
Bien que les pratiques funéraires constituent un terrain d'étude très important dans notre compréhension d'une société ancienne, celles-ci sont très mal connues en ce qui concerne l'Anatolie du deuxième millénaire. Cette lacune est en grande partie due au faible nombre de sites "à tombes" (cimetières ou sites d'habitat) fouillés de manière satisfaisante sur le plateau anatolien mais aussi à la nature fragmentaire de notre documentation les concernant.
Cette dernière est en effet essentiellement archéologique et ne permet de rendre compte que de la partie visible et matérielle des pratiques funéraires, celle qui s'est conservée jusqu'à nous. Cela correspond en somme à la forme des tombes, à la disposition des corps, et à une partie au moins du mobilier funéraire. En l'absence de sources littéraires, l'archéologie ne nous permet donc d'aborder les pratiques funéraires qu'à travers un moment arrêté, le moment ultime auquel aboutissent toutes les cérémonies qui ont pu se dérouler à partir du moment du décès jusqu'à la mise en terre du corps.
Les seules sources littéraires à notre disposition sont postérieures d'un demi-millénaire environ à l'époque qui nous intéresse ici, et bien que très détaillées et passionnantes, elles ne concernent que les rois et reines hittites(1) et ne nous renseignent guère sur les pratiques funéraires des gens du commun. L'archéologie doit donc rester notre point de départ.
La situation des populations du plateau anatolien au tout début du IIe millénaire est assez mal définie. L'implantation des marchands venus d'Assyrie vers le début du XIXe siècle et avec eux, l'introduction de l'écriture cunéiforme en Anatolie nous permet cependant d'entrevoir un peu plus clairement la situation des populations indigènes. Il semble alors que l'Anatolie centrale est divisée en divers petits états princiers rivaux. L'unité ne viendra que deux siècles après le départ des marchands assyriens, avec l'avènement de l'Ancien Royaume hittite au XVIe siècle avant notre ère.
Notre propos n'est pas de revenir ici en détail sur l'utilité de l'étude des pratiques funéraires, mais il nous a semblé tout de même intéressant de rappeler brièvement quelques points les plus importants. L'étude des pratiques funéraires permet d'aborder un aspect des plus cruciaux d'une société : ses rapports avec la mort. Mais à travers les pratiques funéraires, ce sont aussi les structures sociales d'une société qui transparaissent car elles reflètent inévitablement les caractéristiques des individus qui la constituent(2).
Les pratiques funéraires sont aussi le résultat d'actes intentionnels qui trahissent les mentalités d'une société. Cependant nous aurions tort d'attendre d'une étude qu'elle nous renseigne de façon précise sur les croyances religieuses d'une même population. Tout d'abord parce que les pratiques funéraires ne sont pas toujours dépendantes des croyances religieuses et les fluctuations de l'une n'impliquent pas forcément des changements dans l'autre(3). Mais c'est surtout le côté fragmentaire de la documentation rapportée par l'archéologie, déjà abordé plus haut, qui constitue la plus grande limite aux interprétations.
Douze sites "à tombes" sont actuellement connus sur le plateau anatolien pour la période qui nous intéresse ici (voir carte 1). Certains sont des sites d'habitat (Acem Hüyük, Alişar Hüyük, Boğazköy, Karaoğlan, Kültepe, Maşat Hüyük et Polatlı Hüyük) et d'autres des cimetières (Büget / Ferzant, Gordion, Ilıca, Kazankaya, et Osmankayası). La qualité et la quantité des découvertes sont variables sur chaque site, et certains d'entre eux sont totalement inexploitables en raison du caractère beaucoup trop fragmentaire de leur documentation. C'est le cas notamment des sites d'habitat de Acem Hüyük, Karaoğlan, Maşat Hüyük et Polatlı Hüyük, qui chacun ne comportent qu'une seule tombe; ainsi que les cimetières de Büget / Ferzant et Kazankaya qui ont été pillés avant que des fouilles systématiques n'aient pu être entreprises.

Carte 1 - Sites du plateau anatolien et des alentours contenant des tombes (la zone étudiée est grisée).
Il ne reste donc, après élimination, que six sites du plateau anatolien susceptibles de nous fournir des renseignements concernant les pratiques funéraires de la première moitié du IIe millénaire. Ce sont pour les cimetières : Gordion, Osmankayası et Ilıca ; et pour les sites d'habitat : Alişar Hüyük, Kültepe et Boğazköy.
Nous aurions tort de mettre tous ces sites sur le même pied d'égalité car, même s'ils appartiennent à la première moitié du IIe millénaire, ils n'ont pas tous été utilisés de façon contemporaine. Le tableau I présente la répartition chronologique et la durée d'utilisation de chaque site. Les tombes les plus anciennes proviennent de la couche III de Kültepe, tandis que les plus récentes proviennent de Boğazköy et d'Osmankayası.
A première vue, il semble exister une grande diversité des pratiques funéraires en Anatolie centrale au IIe millénaire. Deux grandes pratiques apparemment fondamentalement différentes sont attestées(4) : l'inhumation, qui est largement majoritaire, et l'incinération qui apparaît (à côté de l'inhumation) sur les deux sites d'Osmankayası et d'Ilıca.
La comparaison avec les pratiques funéraires connues au millénaire précédent sur la même zone géographique(5) nous a permis dans un premier temps de distinguer les éléments traditionnels remontant au IIIe millénaire et les éléments nouveaux qui apparaissent au IIe millénaire.
Parmi les éléments traditionnels, nous retrouvons au début du IIe millénaire, les trois grands types d'inhumation déjà bien connus au IIIe millénaire, à savoir, l'inhumation en fosse, en jarre, et en ciste (voir fig. 1). Ces trois pratiques sont contemporaines et cohabitent aisément sur un même site sans qu'il ait été jusqu'ici possible de déterminer les raisons conditionnant le choix d'une pratique plutôt qu'une autre(6). Les corps mis en terre continuent à être disposés en position contractée (dite " en chien de fusil ", voir fig. 2), tandis que le mobilier funéraire reste toujours aussi pauvre et se limite à une ou deux vaisselles de céramiques (le plus souvent une cruche ou un bol) accompagné parfois d'un objet personnel du défunt (sceau, fusaïole, peigne, etc.), sans parler des quelques éléments de parure (boucles d'oreille, anneaux, bracelets ou colliers) propres à l'habillement du mort lors de sa mise en terre. Un cimetière comme celui de Gordion fait exactement le lien avec les cimetières du IIIe millénaire si ce n'est pour l'aspect stylistique de quelques éléments du mobilier funéraire des tombes.

Tableau 1 - Répartition chronologique et régionale des sites étudiés.
Les premiers éléments nouveaux, propres au IIe millénaire, font leur apparition sur les deux sites d'habitat d'Alişar Hüyük et de Kültepe. Sur ces deux sites, la tradition distinguant les adultes inhumés en cimetières des jeunes enfants enterrés dans l'habitat, pourtant bien attestée au IIIe millénaire et au tout début du IIe millénaire (couche III de Kültepe), est subitement brisée par l'apparition massive d'inhumations d'adultes dans l'habitat (couches II et Ib de Kültepe et couches 11 et 10T d'Alişar). Parallèlement à ces inhumations d'adultes, et toujours sur les deux sites d'Alişar Hüyük et de Kültepe, la position étendue, jusqu'alors pratiquement inconnue en Anatolie(7), fait son apparition, également en grand nombre. A Kültepe (mais pas à Alişar), le mobilier funéraire, jusque là très pauvre en quantité et en qualité, se diversifie et s'enrichit de façon spectaculaire dans les couches II et Ib.
Mais la nouveauté la plus frappante du IIe millénaire apparaît aux alentours du XVIIe siècle sur les sites d'Ilıca et d'Osmankayası, il s'agit de l'incinération en urne. Sur ces deux sites pourtant, et il convient de souligner ce fait, l'inhumation continue à être pratiquée de manière contemporaine à l'incinération.

Fig. 1a - Inhumation en jarre (Gordion, tombe H1)

Fig. 1a - Inhumation en fosse (Gordion, tombe H25)

Fig. 1c - Inhumation en ciste (Alişar, tombe dx30)
Nous pensons que nous aurions tort d'étudier toutes ces nouveautés comme un ensemble. Cela reviendrait à réduire les mécanismes à l'apparition de ces nouvelles pratiques à une seule et même cause.
Nous avons la chance pour une partie du IIe millénaire de disposer de sources écrites qui nous renseignent sur le contexte historique de l'Anatolie centrale. La comparaison des observations archéologiques relatives au domaine funéraire avec les sources historiques est ici particulièrement intéressante.

Fig. 2 - Individu en position contractée (Gordion, tombe H22)
Ainsi, l'apparition de la position étendue et les inhumations nombreuses d'adultes sur les sites d'habitat de Kültepe et Alişar semblent coïncider avec l'implantation permanente sur ces deux sites de marchands assyriens au début du XIXe siècle. Il est donc très probable que les nouvelles pratiques observées soient directement liées à l'implantation des kârû assyriens, d'autant plus que ces nouveautés ne se retrouvent plus après le départ des marchands assyriens (couche Ia de Kültepe). Les marchands assyriens vivant de façon permanente sur les kârû anatoliens, et qui lors de leur mort étaient inhumés dans leur habitation, ont ainsi pu apporter avec eux leurs propres conceptions funéraires. Il est cependant difficile de dire dans quelle mesure ces nouvelles pratiques ont influencé la population locale.

Fig.3 - Exemple d'inhumation utilisant trois jarres (Alişar).
La pratique de l'inhumation en position étendue conditionne certainement l'apparition de l'inhumation en deux ou trois jarres telle qu'elle est observée à la même époque sur le site d'Alişar (et uniquement sur ce site), puisqu'elle seule permet de recouvrir la totalité d'un corps adulte en position étendue (voir fig.3). Le développement urbain et économique spectaculaire du site de Kültepe durant sa position de principal kârum anatolien, celui de Kanes, semble également avoir eu des répercussions dans le domaine funéraire, en particulier dans le mobilier funéraire, qui, nous l'avons déjà dit, se diversifie et surtout s'enrichit dans les couches II et Ib.
L'apparition de l'incinération en Anatolie centrale aux alentours du XVIIe siècle ne peut s'expliquer quant à elle de la même façon. Le contexte historique n'est plus le même et les marchands assyriens sont déjà partis de Cappadoce.
Cette apparition est d'autant plus spectaculaire qu'elle n'a pas d'antécédents connu dans la région(8). Plus au sud par contre, sur le site de Gedikli, la pratique de l'incinération est peut-être déjà attestée dès la fin du IIIe millénaire(9).
Cependant, la distance séparant ce site d'Osmankayası et Ilıca est importante et établir une relation entre les deux régions est encore trop hasardeux dans l'état actuel de nos connaissances. De nouvelles découvertes permettraient peut-être de faire la lumière sur ce point.
Malgré le peu d'informations dont nous disposons, nous pouvons tout de même parcourir les différentes possibilités qui s'offrent à nous pour déterminer les origines de l'apparition de l'incinération :
En premier lieu, c'est une origine extérieure qui peut être invoquée. L'introduction de l'incinération pourrait avoir été causée directement par l'installation de populations extra-anatoliennes qui auraient migré jusqu'en Anatolie centrale pour finalement s'y installer dans le deuxième quart du IIe millénaire. Cette explication s'effrite cependant par le manque de populations pratiquant l'incinération suffisamment proches géographiquement et auxquelles nous aurions pu faire remonter l'origine de la pratique en Anatolie(10). Par ailleurs, à une date aussi basse que le XVIIe siècle pour l'apparition de l'incinération, les traces archéologiques ou historiques de la pénétration d'une population allochtone en Anatolie centrale sont totalement inexistantes.
La seconde possibilité qui s'offre à nous est de voir dans l'apparition de l'incinération le résultat d'une évolution et d'un changement interne au sein des populations anatoliennes(11). Cette évolution pourrait être de l'ordre du spirituel, mais aussi résulter d'un changement au niveau des structures sociales. Une société dans laquelle les inégalités entre les vivants sont de plus en plus grandes pourrait ainsi continuer à creuser ces inégalités même après la mort, en distinguant les individus inhumés et les individus incinérés.
L'époque d'apparition de l'incinération, aux alentours du XVIIe siècle, correspond à peu près aux premières tentatives d'unification politique de l'Anatolie qui aboutiront à la création de l'Ancien Royaume hittite au milieu du XVIIe siècle. Ainsi, on peut se demander si l'apparition de l'incinération n'est pas le reflet dans le domaine funéraire de la hiérarchisation plus forte des structures de la société qui peut résulter du passage d'une société constituée de petits états indépendants (comme c'est le cas dans le premier quart du IIe millénaire) à un royaume unifié.
Les sources littéraires du Nouvel Empire nous montrent que dans la deuxième moitié du IIe millénaire, les rois et les reines hittites sont incinérés. Cela est peut-être un indice pour penser que l'incinération était plutôt réservée aux classes sociales élevées tandis que l'inhumation restait le lot des gens du commun.
Nous pensons cependant qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur l'origine de l'incinération et il est possible que de nouvelles données bouleversent tout ce qui a été dit précédemment. Dans l'état actuel de nos connaissances il paraît toutefois difficile d'attribuer l'origine de l'incinération à des populations étrangères.
Au terme de cette étude, la vision un peu chaotique du départ a laissé petit à petit place à une certaine cohérence. Les nouveautés du premier quart du IIe millénaire, d'origine très probablement mésopotamienne, sont en fait très localisées et ne dureront que le temps des kârû cappadociens, tandis que les populations indigènes continuent dans la tradition du IIIe millénaire. Le départ des marchands assyriens puis les premières tentatives d'unification de l'Anatolie centrale qui aboutiront à la création de l'Ancien Royaume hittite annoncent un changement radical dans les structures sociales de ces populations, changement que nous croyons pouvoir rattacher à l'apparition à cette époque de l'incinération qui cohabite avec l'inhumation et qui est vraisemblablement réservée aux classes sociales supérieures.
Les documents archéologiques concernant le domaine funéraire manquent cruellement en ce qui concerne la deuxième moitié du IIe millénaire et il est difficile de dire dans quelle mesure cette situation est durable. Cependant, et bien que de nouvelles fouilles permettraient de faire la lumière sur ce point, il semble bien que celle-ci reste inchangée durant tout le Nouvel Empire hittite.
NOTES
(1)Voir Otten 1958, passim.
(2)Les liens unissant le domaine funéraire à l'organisation sociale ont été mis en évidence avec succès par L.R. Binford à travers l'étude de quarante cas ethnographiques, voir Binford 1972, p. 235.
(3)Phénomène particulièrement bien étudié par P.J. Ucko. Voir Ucko 1969, p. 263.
(4)L'incinération est reconnue par G. Dumézil comme relevant d'une conception de l'au-delà antithétique à celle de l'inhumation (voir Dumézil 1953, p. 147-151). Pourtant de nombreux exemples ethnographiques nous montrent que la coexistence de l'inhumation et de l'incinération au sein d'une même culture n'est pas rare et ne dépend pas forcément des conceptions religieuses mais souvent plutôt du statut social des individus (voir Ucko 1969, p. 198 et 267-268). P.J. Ucko montre également à quel point il est simpliste de faire l'équivalence entre le passage de l'inhumation à l'incinération (ou vice-versa) et l'arrivée de peuples étrangers ou un changement radical dans les croyances religieuses.
(5)Voir Özgüç 1948, passim.
(6)L'inhumation en ciste, plus rare que les deux autres, semble pourtant avoir été plutôt réservée aux personnages adultes (hommes ou femmes) de haut rang. Cela est suggéré principalement par la monumentalité relative et par l'effort nécessaire à la construction d'une telle tombe.
(7)Dans l'état actuel de nos connaissances, la position étendue n'est attestée au IIIe millénaire que sur un seul site, le cimetière de Tekeköy près de Samsun, où quatre inhumations sur un total de seize présentent une position étendue sur le dos. Voir Ozgüç 1948, p. 24.
(8)Les restes de squelettes calcinés retrouvés dans la couche XIX de Yümüktepe (région de Mersin) ont parfois été considérés comme la plus ancienne attestation de la crémation en Anatolie du sud puisque la couche XIX est contemporaine de la période de Halaf. Cependant le fouilleur J. Garstang préfère y voir une " mass cremation in-situ " (J.Garstang 1953, p. III) des habitants par des populations hostiles lors d'une attaque du site.
(9)Voir Alkim 1966, p. 27-57. L'incinération y est attestée de façon contemporaine à l'inhumation qui reste toutefois largement majoritaire. Le fouilleur voit dans l'apparition de l'incinération les traces matérielles d'une invasion de populations étrangères (Alkim 1966, p. 36).
(10)Outre l'attestation à Gedikli dans l'extrême sud-est anatolien, l'incinération est attestée en Europe centrale et balkanique au IIIe millénaire, mais de façon très sporadique (à chaque fois l'inhumation reste largement majoritaire). Dans le sud de la Russie, dans la phase récente de la culture de Tripolye, l'incinération est également attestée pour une période à peu près contemporaine à son apparition en Anatolie. Pour des références plus précises, voir Bittel 1958, p. 31-32 avec renvois bibliographiques.
(11)Nous avons déjà précisé qu'il n'est pas du tout inconcevable que les deux pratiques (inhumation et incinération) cohabitent au sein d'une même culture. Voir note 4.
BIBLIOGRAPHIE
- ALKIM U.B. (1966), "Excavations at Gedikli (Karahöyük) - first preliminary report", Belleten XXX, p. 27-57.
- BINFORD L.R. (1972), " Mortuary practices : their study and their potential "in An Archaeological Perspective, Seminar Press, New York, p. 208-243.
- BITTEL K. (1958), Die Hethitischen Grabfunde vom Osmankayası, WVDOG 71.
- DELIYANNIS Y. (1997), Les pratiques funéraires sur le plateau anatolien durant la première moitié du deuxième millénaire, mémoire de maîtrise, Université de Paris-I, non-publiée.
- DUMEZIL G. (1953), La saga de Hadingus, Paris.
- EMRE K. (1991), "Cemeteries of the second millenium BC in central Anatolia "dans Essays on ancient anatolian and syrian studies in the 2nd and 1st millenium BC (Bulletin of the Middle Eastern culture center in Japan 4), Wiesbaden, p. 1-15.
- GARSTANG J. (1953), Prehistoric Mersin-Yümüktepe in southern Turkey, Oxford.
- MELLINK M. (1956), A hittite cemetery at Gordion, Philadelphia.
- ORTHMANN W. (1967), Das Gräberfeld bei Ilıca, Wiesbaden.
- OTTEN H. (1958), Hethitische Totenrituale, Berlin.
- ÖZGÜÇ T. (1948), Die Bestattungsbräuche im vorgeschichtlichen Anatolien, Ankara.
- UCKO P.J. (1969), "Ethnography and archaeological interpretation of funerary remains ", World Archaeology vol. I, no.2, pp. 262-281.