hatti [ha-at-ti]
association des amis de la civilisation hittite

Menu:
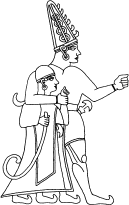
PRESERVATION ET RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET OEUVRES D'ART
par H. Chauffriat, Paris.
Souvent présenté comme un phénomène moderne, uniquement associé à la pollution atmosphérique liée à l'ère industrielle, l'altération des matériaux est en fait un processus naturel et irréversible. Ces altérations inhérentes à la nature des matériaux pierreux employés et à leurs conditions de mise en oeuvre, existent également sur les affleurements naturels; il n'est besoin pour s'en convaincre que d'observer les amoncellements de gravier et de sable que l'on trouve aux pieds des falaises en calcaire, en grès ou même en granite.
Les dégâts causés à la pierre de taille par l'emprise du temps ont des causes diverses :
- La qualité intrinsèque du matériau, son utilisation plus ou moins judicieuse et les facteurs climatiques sont des causes primaires déterminant directement la durabilité de ce matériau.
- A ces causes naturelles se sont ajoutées des causes nouvelles : l'urbanisation et la révolution industrielle, c'est-à-dire à ce qu'on appelle aujourd'hui la pollution. Il serait faux de croire que le problème de la pollution est strictement contemporain, déjà en 1273 à Londres, il était interdit de brûler certains combustibles dont les fumées détérioraient les peintures décorant les édifices.
Les effets de la pollution atmosphérique s'ajoutant aux causes naturelles, il est normal que les processus de dégradation de la pierre de taille se soient accélérés dans certaines conditions ces dernières décennies.
Partant de ces constatations, plusieurs questions se posent quant aux dégradations qui affectent notre patrimoine artistique et culturel :
- En quoi consistent les altérations de nos monuments ?
- Comment peut-on intervenir pour limiter sinon empêcher ces dégradations, c'est-à-dire pour conserver le plus longtemps possible dans leur intégralité et leur authenticité les bâtiments et sculptures.
I - Les modifications des matériaux pierreux
1. La patine
Les patines se traduisent par un changement de couleur et/ou une modification superficielle de la texture. Elles résultent de la migration vers la surface de la pierre de constituants présents dans la masse du matériau. Le grain de la pierre s'adoucit. La patine la plus connue est le calcin qui se forme sur les roches calcaires par dépôt de calcite. Bien que le rôle de la patine apparaisse souvent comme bénéfique car sa formation tend à améliorer le comportement des roches vis-à-vis du gel ou de certains sels, sa formation n'est rien d'autre qu'un processus de détérioration par appauvrissement en liant des parties plus profondes de la pierre.
2. L'action de l'eau
L'eau facilite les processus de détérioration des roches par voie chimique, biologique, et dans certains cas, physique. Elle peut agir soit directement sur les parties exposées aux intempéries (pluie, neige, grêle, brouillard), soit par condensation de la vapeur d'eau lors des variations de température et d'humidité. L'eau chargée de composants nuisibles (sels) peut remonter par capillarité ou être introduite par les mortiers de maçonneries, ou bien être apportée par le vent si le matériau est situé à proximité de la mer.
La détérioration des pierres sous l'action de l'eau est provoquée par la dissolution, la dilatation, et le lessivage des composants des roches. Les calcaires et les grès calcaireux sont les plus sensibles à l'action de l'eau. La présence de dioxyde de carbone qui la transforme en une solution faible d'acide carbonique augmente considérablement son pouvoir de dissolution. Le carbonate de calcium peu soluble (0.015 g/l) est ainsi transformé en carbonate de calcium acide ayant une solubilité cent fois plus grande (1.66 g/l). Le carbonate de calcium acide n'étant soluble que dans des solutions aqueuses, il se retransforme à la surface de la pierre lors du séchage en carbonate de calcium neutre. Le carbonate de calcium acide peut aussi bien se précipiter dans les pores superficiels que se déposer à la surface de la pierre. Dans les deux cas, il contribuera à l'étanchement de la pierre. La localisation du carbonate de calcium amorphe dans la pierre, sera fonction de la porosité de la pierre, de sa texture, de la vitesse de séchage et la fréquence des cycles humidification/dessiccation. On peut en conclure que l'action soldante de l'eau appauvrit en liant les couches internes de la pierre et enrichit les couches superficielles.
3. L'action des gaz de l'atmosphère et de la pollution de l'air
L'action des gaz de l'atmosphère sur les pierres est particulièrement sensible, notamment celles du dioxyde de soufre et du trioxyde d'azote qui se transforment par oxydation et hydrolyse en acide sulfurique et nitrique. Ces composés qui sont des acides puissants ont un effet destructif sur les minéraux composant les roches et entrent facilement en réaction avec les carbonates en les décomposant. Les pierres calcaires et les grès au ciment calcaire sont les roches les plus sensibles. Le carbonate de calcium décomposé par l'action de ces acides donne naissance aux sels suivants : CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + CO2 + H2O, CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + CO2 + H2O. Les nouveaux composés générés sont beaucoup plus solubles que le carbonate de calcium, environ 150 fois dans le cas du gypse qui cristallise avec deux molécules d'eau et plus de 100g/l pour les nitrates qui eux cristallisent avec 3 ou 4 molécules d'eau.
Ces réactions se produisent à la surface de la pierre et attaquent graduellement les couches profondes du matériau. Les nitrates sont partiellement lessivés par la pluie et migrent en partie sous forme de solution dans la pierre où ils participent au processus de décomposition. Par contre, les sulfates se déposent à la surface de la pierre et contribuent à son étanchement. Ce dernier est facilité puisque le volume du gypse (CaSO4, 2H2O) est de 100% plus grand que celui du carbonate d'origine. A cause de ces dépôts, la pierre "grandit", une couche de plus en plus étanche se formant à sa surface.
L'action des sels, formés par la décomposition du carbonate de calcium par ces acides, est encore renforcée par les dépôts de suies car elles contribuent à l'étanchement de la pierre et de ce fait favorisent la condensation de la vapeur d'eau et retiennent l'humidité saturée de substances agressives. On a observé très souvent que sous les encroûtements noirs il existe presque toujours une couche gypseuse dans laquelle sont inclus des fragments détachés de la roche sous-jacente. Lorsque l'encroûtement gypseux atteint une certaine épaisseur, il tend à se détacher en formant des cloques, des pustules. Sous ces encroûtements la roche apparaît pulvérulente et elle peut alors s'éroder rapidement sur plusieurs centimètres.
4. L'action des sels solubles dans l'eau
Les sels transportés par l'eau sont également très néfastes. Leurs origines sont très diverses, ils peuvent provenir des processus chimiques liés à la pollution, ou être issus du sol dans le cas des remontées capillaires, ou être introduits par les mortiers et les enduits. Les sels présents dans les solutions qui saturent la pierre se cristallisent lors du séchage à la surface mais aussi dans les couches profondes de la pierre en fonction de leur degré de solubilité. Suivant le genre et la quantité de sels cristallisant à la surface de la pierre, il peut se former des taches, des efflorescences, des suintements, des dépôts plus ou moins mous (sulfate de sodium), durs et compacts (sulfate de carbonate de calcium), des films vitreux (sulfate de potassium), etc. La cristallisation des sels qui s'accompagne d'une augmentation du volume des cristaux dans les pores engendre une pression, souvent considérable, et suffisante pour provoquer par son action répétée, la détérioration de la pierre. En premier lieu on assistera à la dislocation des couches superficielles puis à la désintégration granulaire, à l'écaillage, à la fissuration donc à la décomposition de la pierre.
Les sels cristallisables causent généralement plus de dommages dans les pores et les micro-fissures de la pierre qu'à sa surface. L'intensité des détériorations est directement liée à la fréquence des cycles humidification/séchage, à la concentration des sels, à leur hydroscopité et leur aptitude à la cristallisation.
5. L'action des variations de température
Parmi les agents naturels détériorant les pierres, on peut citer les variations de température, c'est un processus physique. Elles ont des conséquences particulièrement néfastes si elles sont fréquentes, rapprochées et de grande amplitude. L'agent intermédiaire facilitant ce processus est l'eau. En se congelant, l'eau augmente son volume d'environ 9% à 0 degrés C. [...] La pression exercée par la glace augmente au fur et à mesure que la température diminue.[...] L'action destructrice de l'eau dépend de son degré de remplissage dans les pores, de leur grandeur, de leur forme. Les variations de température peuvent jouer un rôle important dans les milieux privés d'eau. Les altérations sont alors dues aux différents coefficients de dilatation thermique des minéraux constituant la roche. Ceci est particulièrement fréquent dans les marbres à gros cristaux. La juxtaposition de matériaux ayant des coefficients de dilatation différents est souvent à l'origine de désordres importants.
Les dépôts ayant bien souvent des coefficients de dilatation différents de ceux des pierres sur lesquelles ils se développent, les pressions de cisaillement provoquées par les changements de température conduisent à la fissuration puis au détachement de ces couches.
6. L'action des facteurs mécaniques
Il s'agit essentiellement des dégradations qui provoquent l'altération de la pierre par abrasion, fissuration ou corrosion.
- Le vent qui soulève les poussières, le sable, et les projette à la surface peut causer de graves dommages. Les pierres tendres (calcaires) sont particulièrement sujettes à ce genre d'altération, surtout si elles sont abrasées par un matériau dur présentant des arêtes vives.
- La grêle lorsqu'elle vient frapper les parties affaiblies de la pierre.
- Les vibrations, les chocs sont souvent à l'origine de fissures qui atteignent même la pierre saine.
- Les raccords en fer (chevilles, boulons d'ancrage) qui lorsqu'ils se corrodent augmentent de volume (rouille) et engendrent une pression sur les parois voisines du scellement, ce qui entraîne une fissuration multiple de la pierre.
7. L'action des facteurs biologiques
Les détériorations liées aux micro-organismes, bactéries et champignons sont liées à la présence d'une humidité constante. Leur développement s'accompagne d'une augmentation du taux d'humidité, d'efflorescences, de taches colorées, de boursouflures et du détachement des couches superficielles. La présence de végétation à la surface ou dans les pores de la pierre va :
- provoquer la décomposition du carbonate de calcium sous l'action des acides végétaux.
- provoquer l'apparition de nouvelles fissures et de nouveaux éclats à la surface suite au développement des racines de ces mêmes végétaux qui s'infiltrent dans les fentes de la pierre.
- contribuer à la formation d'une couche compacte qui, de façon purement mécanique, étanche la surface et freine l'évaporation de l'eau. L'isolation extérieure formée par la végétation crée une ombre constante qui entretient l'humidité de la pierre.
On a vu dans les paragraphes précédents que la détérioration de la pierre à des causes diverses. La qualité intrinsèque de la roche, son utilisation plus ou moins judicieuses, les facteurs climatiques, la pollution, déterminent directement la durabilité du matériau. A la base de presque toutes les altérations, il y a un élément commun : L'EAU. L'eau est l'ennemie, elle constitue par excellence l'agent agressif ou le catalyseur de l'agression. En conséquence, nous ne parviendrons à conserver notre patrimoine qu'en empêchant l'eau et les agents agressifs qu'elle contient de s'infiltrer dans la pierre.
II - Restauration et Conservation
1. La consolidation des matériaux pierreux par les silicones
La désagrégation de la pierre correspond à la solubilisation du liant par transformation chimique puis à la migration des sels formés vers la partie externe de la pierre. La perte de liant entraîne une augmentation du volume poreux et l'affaiblissement des propriétés mécaniques. La conservation de la pierre doit avoir pour objectif un apport de liant pour remplacer celui qui a été détruit et une protection pour empêcher les pénétrations d'eau afin d'éliminer les altérations futures. L'agent de consolidation devra donc répondre aux exigences suivantes :
- un apport de liant d'origine minérale résistant aux dissolutions.
- un grand pouvoir de pénétration pour assurer la liaison entre la zone saine et la zone altérée.
- ne pas former de composés nuisibles (sels, etc.).
- ne pas engendrer des modifications susceptibles d'altérer la perméabilité à la vapeur d'eau et le coefficient de dilatation à la chaleur.
- ne pas modifier la couleur de la pierre.
- réduire la capacité d'absorption d'eau de la pierre.
Si l'on considère que les greffes ne prennent que si les tissus du porte greffe et du greffon sont identiques, l'agent de conservation de la pierre doit obligatoirement avoir la même origine, c'est-à-dire minérale. A l'inverse des colles, des huiles, des gélatines, des silicates, dont l'utilisation remonte pour certains au Moyen Age, les Rhodorsil consolidants à base d'esters de l'acide silicique répondent parfaitement aux exigences précitées.
Le Rhodorsil consolidant RC70, est, lors de l'application, absorbé par le réseau capillaire. Sous l'action de l'eau résiduelle contenue dans les pores et d'un catalyseur neutre qui favorise la réaction, les esters de l'acide silicique s'hydrolysent pour former un gel d'acide silicique. Ce gel qui est instable donne naissance après transformation à du dioxyde de silicium, composé ayant une structure voisine du quartz, élément présent dans de nombreuses pierres.
[...] Les résines silicones présentent l'avantage sur l'ester d'acide silicique d'apporter des groupements R à propriétés spécifiques, et d'avoir une structure plus ou moins filmogène dont on peut régler la souplesse. [...] Voici quelques propriété des résines silicones particulièrement intéressantes pour la protection des matériaux :
- la faible tension superficielle se traduite par une facilité d'étalement d'où une bonne pénétration.
- l'inertie chimique permet une bonne tenue aux agents atmosphériques et aux radiations.
- le pouvoir hydrofuge, lié au caractère non-polaire des groupements méthyles, limite les transferts d'eau à l'état liquide; le caractère très hydrophobe étant illustré par l'apparition de l'effet perlant.
- la perméabilité aux gaz permet de maintenir les transferts d'eau à l'état de vapeur.
- la flexibilité liée à la présence de groupements méthyles mais surtout méthylphényles se traduit par une bonne tenue aux contraintes mécaniques.
- leur squelette a une structure analogue à celle des minéraux siliceux.
L'association d'ester d'acide silicique avec des résines silicones a permis d'élaborer différents consolidants aux propriétés spécifiques, ainsi :
- le Rhodorsil consolidant RC80, à base d'ester d'acide silicique et de résine méthylpolysiloxanique, confère au matériau consolidé des propriétés hydrophobes puissantes sur une profondeur équivalente à celle atteinte par le consolidât lui-même. Ceci aura pour conséquence de déplacer la zone de condensation vers l'intérieur du matériau ce qui diminue considérablement les risques de condensation au voisinage de l'épiderme.
- le Rhodorsil consolidant RC90, à base d'ester d'acide silicique et d'une résine méthylphénylpolysiloxanique, possède une très grande flexibilité et une bonne résistance aux UV. Il est particulièrement adapté pour les supports ayant de fortes hétérogénéités ou très pulvérulents tels que, par exemple, les marbres saccharoïdes.
2. Conservation : Un post-traitement indispensable, l'hydrofugation de surface
Les consolidants organo-siliciques n'ont pas ou peu de fonction hydrofuge, hormis le consolidant RC80, il est donc nécessaire d'assurer une protection efficace des matériaux restaurés contre les intempéries. On terminera donc la restauration par l'application en surface d'un hydrofugeant silicone. Cette fonction est indispensable si l'on ne veut pas voir réapparaître les désordres que l'on vient de corriger. L'application à posteriori de l'hydrofugeant Rhodorsil H224 à base de résines riches en radicaux méthyles (CH3) non polaires, limite les transferts d'eau à l'état liquide, sans s'opposer à la diffusion de la vapeur d'eau. En effet, grâce à sa très basse tension superficielle, l'hydrofuge va s'étaler sur les parois du poreux, en formant une couche monomoléculaire qui ne réduira pas la taille des pores. Le caractère très hydrophobe du film sec qui va s'opposer à la pénétration de l'eau liquide est illustré par l'apparition de l'effet perlant, phénomène bien connu de la goutte d'eau.
Les résines silicones, tant dans nos laboratoires que par de nombreuses réalisations pratiques déjà anciennes, ont fait la preuve de leur efficacité tant dans la consolidation que l'hydrofugation. C'est pourquoi ces produits sont d'une aide précieuse notamment dans le domaine de la restauration et nous sommes heureux de les faire connaître à ceux qui les découvrent.